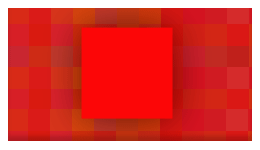Ce texte est anonyme. Il circule entre les étudiants en grève au Québec et ailleurs. Nous le reproduisons ici parce qu’il donne à penser à ce qu’est une université. Est-ce un simple espace réel, mais de plus en plus virtualisé, où l’étudiant de passage investit à crédit dans un avenir incertain ? Ou bien, l’Université en tant que territoire urbain et les étudiants en tant que population spécifique mais incluse dans la cité, ont-ils un rôle à jouer, différent peut-être, mais en symbiose avec l’ensemble de la société et donc à préserver des logiques marchandes et financières ? Pis, l’université en tant que territoire n’est-elle pas fondamentale à la cité dans son ensemble et à la ville, ou la métropole, en particulier, dans le sens où elle en est une des racines ?
***
LES ZONÉS DE LA COLONIE UNIVERSITAIRE S’AGITENT
Les administrateurs du présent rêvent monstrueusement. Ils contemplent une université sans lieu ni architecture. Telle une grande verrière gothique, transparente dans le contrejour de la métropole, éclairée par la lumière glauque du monde, presque liquide dans le réseau de ses succursales, elle se tiendrait là.
Dans leur hybris immobilière, les gestionnaires déracinent ce qu’il reste des campus de la ville pour installer temporairement des pavillons épars et ressemblants. La dissémination de l’université n’a d’égale que la juxtaposition infinie de ses programmes et la réduction en miniature de ses spécialisations. Au néon publicitaire, le rayonnement des universités inonde les quais souterrains du métro. Le cours à distance devient le paradigme actuel des études, pendant que le local en location en est déjà l’environnement normal. Tableaux-téléviseurs, images-tactiles, machines-professeurs, domine le fétiche sexuel comme outil pédagogique dans nos salles de classe, d’où l’on chasse le corps érotique. On nous rappelle où nous sommes : dans le fantasme de la présence.
C’est dans un tel non-lieu que le ministère peut prier chaque étudiant d’avoir la fantaisie utile d’imaginer son endettement sous l’image renversée d’un placement. En fait, le seuil de l’institution ne sera pas passé sans que l’étudiant se soit inscrit dans l’espace métaphysique de la finance, où s’élève lentement, sans fissure apparente, la pesante bulle d’une variante grotesque du crédit. La dette est l’eau baptismale du monde vrai dans laquelle l’étudiant peut contempler sa valeur. Elle est en même temps la première ponction consentie sur la commune propriété. À ce titre, l’endettement universitaire n’est pas seulement notre nouveau rite de passage. Il est la garantie même que l’université ne sera qu’un transit anal du marché. L’hypothèque universitaire installe ainsi toutes les thèses à venir dans la honte d’avoir été graciées.
Mais aucune communauté étudiante, aucune vie intellectuelle ne s’est jamais formée dans de tels interstices. Le retrait de l’université dans son enceinte a toujours été une prise de racines encore plus profonde dans la vie des villes, et non une fuite vers l’idéal et l’extériorité. Si une dette est à payer, c’est à la vie étudiante qu’elle est due, et à ses poussées radicales. À ce titre, la grève actuelle a surtout le mérite de provoquer les directions d’établissement à prononcer ce mot d’ordre étrangement rigide et familier : « Circulez ! ». Au moindre désir d’occupation des lieux, les portes se ferment, et les édifices empruntent alors un peu au silence des monuments. Les lieux d’appartenance d’une communauté deviennent des zones annexées au territoire policier, closes au gré des caprices des directions, doucement défendues par le service des communications. Le souvenir de l’université comme lieu d’asile apparaît aujourd’hui comme un dérèglement de la mémoire.
Pour les nouveaux recteurs, l’horizon tranquille des terrains de stationnement est préférable à ce que des amphithéâtres, des bibliothèques, des halls et des rues deviennent des lieux habités par un mouvement, c’est-à-dire peuplés, vécus, rythmés par des moments de vie concrète, d’expérience politique. Car l’université est à habiter : et on habite non une zone mais un monde, à partir des œuvres qui le travaillent et non des diplômes qui le servent. En attendant, les institutions deviennent des comptoirs de service où l’on s’adresse aux étudiants comme à des clients intéressés, des hôtes pacifiés, bref : des étrangers. Le geste autochtone de prendre la rue rappelle donc aujourd’hui ceci que la place de la ville est dans l’université. C’est là que l’étudiant est chez lui et c’est là que, sans dette morale, ni frais d’hospitalité, il peut demeurer.
La grève étudiante est anticoloniale.
Haut bureau de l’agit-prop
Montréal, 21 mars 2012
Guillaume Roberge-Tanguay étudie le cinéma, se souvient parfois d’être québécois et cultive sa féminité.